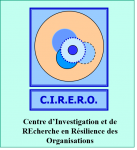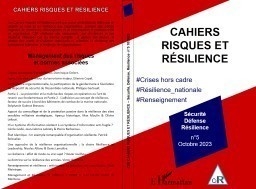Le présent numéro de la revue C2R a pour objectif de présenter des travaux de chercheurs, mais aussi des témoignages de retour d’expériences de praticiens de terrain, civils et militaires, ayant eu à gérer, au cours de leurs activités professionnelles, des situations de crise, dont certaines dites « hors cadre ». Leur perception concrète du concept de résilience était donc intéressante à recueillir.
L’actualité nous montre en effet que les sociétés technologiquement avancées, si elles ont amélioré l’efficacité productive des organisations qu’elles ont mise en place, ont aussi accru considérablement leur vulnérabilité aux « grains de sable » perturbateurs imprévus, voire imprédictibles. Syndrome du « Cygne noir » et illustration de la célèbre formulation de Paul Valery à l’issue de la Grande Guerre : « Nous autres, civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortelles ».
Le premier article est rédigé par Dominique Delort, General de Corps d’Armée (2S), ESGN, IHEDN. Après une longue expérience de gestions des crises sur le terrain en OPEX (FINUL Liban, Rwanda ...). Le général Delort témoigne de son retour d’expérience au vu des crises qu’il a eu à gérer comme chef du Centre Opérationnel Interarmées (COIA) et conseiller direct du Gouvernement de 1997 à 2000. Le COIA devenu Centre de Planification et de conduite des Opérations (CPCO) agit comme « cellule de résilience » activée en permanence h-24. Ce centre a autorité sur les forces armées. Il est chargé de réagir en temps réel aux crises extérieures en présentant au pouvoir politique le choix des différentes options documentées et argumentées en termes de moyens requis et de conséquences (avantages/inconvénients) possibles en fonction de l’objectif politique et géostratégique recherché.
Le général de brigade aérienne (2S) Etienne Copel reprend, en les actualisant au vu de la guerre en Ukraine, les recommandations qu’il formule depuis plus de trois décennies dans le cadre du HCFDC/HCFRN pour prévenir les agressions hostiles de types malveillantes, terroristes, voire militaires, sur les installations industrielles à très haut risques potentiels (centrales nucléaires, barrages hydro-électriques, industrie chimique …) et réduire les risques de catastrophes. Parmi les mesures proposées, il préconise la réactivation du Service militaire obligatoire qui permet de disposer en permanence de personnels de protection et d’intervention immédiatement utilisables.
Philippe Gerbault, général de brigade (2S) témoigne de son retour d’expérience comme commandant militaire du Palais Bourbon. Il était chargé de la protection de l’Assemblée nationale, dans une période de montée de la menace terroriste et de la violence dans un climat sociétal parfois tendu. Sa formation initiale dans les troupes aéroportées lui a permis d’adapter aux circonstances la méthode MRT (Méthode de Raisonnement Tactique) familière aux combattants de terrain.
La capitaine de vaisseau Stéphanie Guenot Bresson, en fonction à l’État-major de la Marine, présente dans une première partie la doctrine de maîtrise des risques dans le cadre d’opérations extérieures interarmées (OPEX) dans un environnement qui peut être rapidement évolutif sinon hostile. La méthode PRiSM (Prise de Risques Mesurés) mise en œuvre par les Armées lors de la crise sanitaire de 2020 a démontré son efficacité en étant adaptée aux OPEX.
Dans une seconde partie, l’auteure présente la doctrine de maîtrise des risques à bord des navires de la marine nationale. Cette maîtrise repose sur la formation, l'entraînement l'esprit d’équipe et la force morale des équipages qui mettent en œuvre les navires dans des conditions pouvant être extrêmes et sans secours extérieur possible.
Max Moulin, Capitaine de vaisseau (H) et Olivier Leloué, architecte, en fonction au Centre d’expertise du Service d’infrastructures de la Défense, expert en protection passive et camouflage décrivent la démarche qui a été mise en œuvre pour assurer la résilience des sites sensibles militaires à vocation stratégique. L’objectif est d’adapter leur système de protection passive à l'évolution des menaces. Parmi les mesures passives, le camouflage pratiqué lors des deux guerres mondiales, mais jugé obsolète face aux moyens de détection des grandes puissances, a retrouvé toute sa pertinence face aux nouvelles menaces asymétriques terroristes comme aux attaques militaires réapparues avec la guerre en Ukraine.
Cécile Godé et Jean-Fabrice Lebraty, tous deux professeurs universitaires et Pierre Barbaroux, Enseignant-chercheur (HDR), présentent les résultats de leurs travaux dans le domaine de la résilience des systèmes d’information avec la conception de systèmes dits anti-fragiles. L’anti-fragilité, répondant à un besoin militaire initial, est désormais un critère d’importance vitale. Comme le montre l’actualité.
Patrick Boisselier, Professeur universitaire au CNAM Paris, analyse dans une approche systémique pluridisciplinaire les facteurs de résilience organisationnelle de l’État Islamique (EI) en Irak et au Levant après avoir été neutralisé militairement par les forces armées de la Communauté internationale. Il propose dans un premier temps de réfléchir aux fondements idéologiques et politiques de l’état islamique et dans un second temps l’auteur analyse la capacité de l’EI à faire face aux turbulences et son aptitude à continuer à exister en font un modèle de résilience organisationnelle. Enfin, pour le chercheur Boisselier, les causes fondamentales sont la démographie et le changement climatique qui constitue l’essence même de la résilience de l’EI.
Xavier Guilhou, capitaine de vaisseau (H) expose la problématique de la gestion des crises hors cadre auxquelles les militaires et plus particulièrement les marins, sont par nature et expérience de terrain, sans doute mieux préparés que les administrations et structures civiles dans les sociétés occidentales. L’auteur nous dit qu’il ne faut pas confondre résilience et continuité d’activité et qu’il faut accepter l’incertitude et dominer nos peurs.
Nicolas Alfano, professeur et chercheur à l’École navale et Denis Lemaître, codirecteur de la chaire leadership et résilience présentent leur philosophie dans l’étude de la résilience et l’enseignement scientifique dispensé aux élèves officiers de l’École navale. Ils s’appuient sur l’exemple concret des Sapeurs-pompiers, la sécurité incendie étant à bord des navires une nécessité permanente vitale.
Victor Bernaud, en fonction au Centre des Interarmées du CICDE (Concepts, Doctrines et Expérimentations) présente le document de doctrines interarmées relatif à la résilience dont il a dirigé l’élaboration en application du concept mentionné dans le LBDSN 2008.
Alain Meininger, administrateur civil hors classe, spécialiste des questions internationales et de prospective géostratégique ayant exercé au ministère des Armées porte témoignage sur son retour d’expérience au sein de la communauté du renseignement et de sa perception du rôle de l’anticipation et de la réduction des incertitudes comme facteurs de résilience nationale. Bien que le rapprochement entre le concept de résilience et l’activité de renseignement peut paraître étrange. L’auteur montre comment ce concept, issu des sciences physiques, en se transformant en une capacité à surmonter les traumatismes, trouve aussi une forme de pertinence en lien avec l’activité « renseignementale ».
Jean Claude Guion de Meritens, ingénieur-conseil à l’international, ancien pilote de chasse dans l’Armée de l’Air, présente sa conception d’une nouvelle méthode dite PHSM (Production, Humain, Structure, Méthode) qu’il a eu l’occasion de mettre en pratique avec succès lors de la conception et de la construction de nouvelles usines, puis dans le cadre de l’amélioration de l’activité de plusieurs entreprises allant de la PME au grand groupe industriel et comment cette méthode peut contribuer à la résilience des organisations.